Les principaux symptômes du TDAH sont présents pendant toutes les phases de la vie, mais à différentes intensités.

L’hyperactivité se caractérise, entre autres, par le fait que la personne est constamment en mouvement et donne l’impression d’être montée sur des ressorts. Elle se sent «sous tension» et a de la difficulté à rester assise tranquillement pendant une longue période. De même, l’hyperactivité se manifeste par le fait de parler excessivement.
L’impulsivité se traduit par le fait que la personne touchée perturbe les autres dans leurs occupations ou leur coupe la parole et anticipe. Elle prend des décisions non réfléchies, sans penser aux conséquences. Elle cherche principalement à terminer rapidement une tâche; les détails sont souvent négligés. Dans leur comportement social, les personnes touchées gênent souvent les autres, ce qui nuit à leurs interactions avec d’autres personnes au quotidien.

L’inattention se caractérise par une distraction accrue et une difficulté à écouter longtemps. Parmi les autres problèmes, on note la répartition du temps, l’auto-organisation («procrastination ») et l’accomplissement des tâches. La personne touchée évite aussi intuitivement les tâches nécessitant une attention soutenue pendant longtemps. Elle perd généralement de nombreux objets et passe beaucoup de temps à les chercher.

Les symptômes de TDAH évoluent parallèlement à l’âge de la personne touchée. Ainsi, l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité sont aussi les symptômes principaux chez les adultes atteints de TDAH, mais on observe des variations dans leur intensité. L’agitation motrice des enfants et des adolescents est remplacée dans la plupart des cas par une «agitation intérieure» chez l’adulte. De même, l’impulsivité a sa propre forme d’expression, qui diffère de celle observée chez les enfants et les adolescents. Ici, l’impatience et l’évitement des événements longs sont à l’avant-plan. Les situations quotidiennes qui demandent de la patience, par exemple de faire la queue à la caisse, sont également évitées dans la mesure du possible.
De plus des symptômes clés du TDAH, on observe à l’âge adulte d’autres symptômes, comme la désorganisation dans la vie quotidienne, les sautes d’humeur rapides, l’hypersensibilité au stress et la difficulté à contrôler le tempérament. En outre, le manque de confiance en soi peut aussi être un symptôme observé chez la personne touchée.

Le TDAH est une maladie ayant de fortes bases génétiques. Si les parents sont atteints de TDAH, l’enfant a cinq fois plus de risque d’être atteint en raison de son héritage génétique.
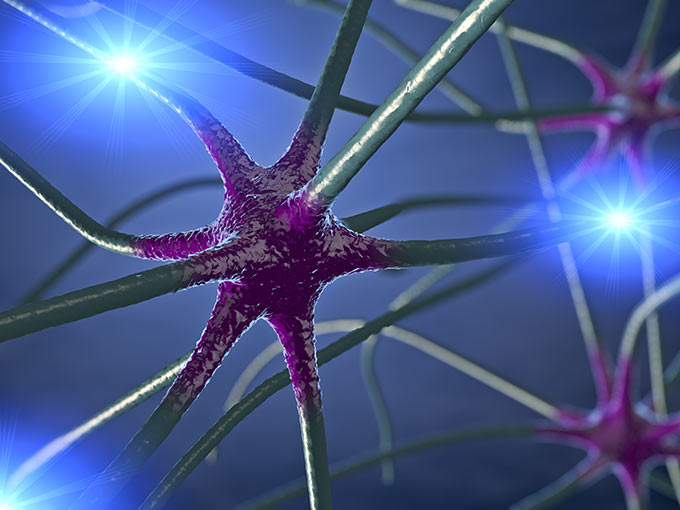
Le TDAH est attribuable à un dysfonctionnement des systèmes de neurotransmission centraux. Cela signifie qu’il n’y a pas suffisamment de neurotransmetteurs disponibles dans l’espace entre deux cellules nerveuses. Cet approvisionnement insuffisant entraîne un dysfonctionnement du cerveau. Il se produit donc dans le TDAH une surstimulation permanente de certaines parties du cerveau.
Ce dysfonctionnement affecte les zones du cerveau où se trouve le système d'attention. Le traitement de l'information et de l'attention soutenue sont également affectés.



Des conditions environnementales défavorables peuvent augmenter le risque d’être touché par le TDAH. Parmi celles-ci, l’on compte les complications périnatales, un faible poids à la naissance, des situations familiales instables et sans structure, un stress dû à des maladies addictives ou d’autres facteurs. Par des influences environnementales défavorables, certaines constellations génétiques à risque sont ainsi susceptibles de favoriser le déclenchement du TDAH.
Le diagnostic de TDAH chez l’adulte est basé sur un examen clinique. Selon DSM-5 (cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), l’instrument diagnostic américain, la détection de 18 critères diagnostiques (tableau 1) joue ici un rôle central. Neuf caractéristiques sont recherchées pour établir le trouble de l’attention et neuf autres, pour établir le trouble de l’hyperactivité et de l’impulsivité.

Tableau 1: Caractéristiques du trouble de l’attention ainsi que de l’hyperactivité et de l’impulsivité selon le DSM-5

Il faut en outre établir que les différents symptômes étaient déjà présents chez la personne touchée avant l’âge de 12 ans. De plus, les difficultés liées au TDAH doivent être reconnaissables dans plus d’un domaine de vie. Finalement, il faut prouver que le trouble entraîne des restrictions fonctionnelles dans la vie quotidienne et nuit à la qualité de vie de la personne touchée.
Une évaluation par des tiers est utile pour le diagnostic, mais souvent compliquée (informations des parents ou des partenaires / bulletins scolaires / certificats de travail).
Il existe différents questionnaires dans le cadre d’une auto-évaluation pour déterminer si le TDAH peut être établi.
Vous trouverez en annexe du guide un autotest, fourni par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les tests neuropsychologiques sont utiles pour répondre à des questions particulières. Toutefois, des instruments neuropsychologiques peuvent être utilisés au besoin dans la surveillance du traitement.

La psychoéducation se répartit entre éducation, conseil et orientation. Dans ce processus, on explique aux patients et, éventuellement, à leur environnement immédiat, les perturbations. On y présente et amorce aussi les formes de traitement.
Il est important de noter que le diagnostic de TDAH chez l’adulte n’implique pas obligatoirement la nécessité d’un traitement. On détermine donc précisément dans ce contexte si les limitations fonctionnelles dans la vie de la personne touchée et les problèmes associés dans la vie sociale sont clairement causés par le TDAH. Le niveau de souffrance de la personne touchée est ici décisif.
La majorité des adultes atteints de TDAH souffrent de maladies concomitantes telles que la dépression, l’anxiété, des troubles de dépendance ou des troubles du sommeil. Selon la gravité de ces maladies concomitantes, la priorité doit être donnée à ce traitement. Le spécialiste doit établir les priorités dans la planification du traitement.

L’objectif principal du traitement du TDAH est de réduire la souffrance subjective et d’augmenter la qualité de vie. Il existe diverses options thérapeutiques, qui peuvent être utilisées seules ou en association. Il faut établir un concept thérapeutique propre à chaque patient en fonction de la gravité des symptômes et des limitations au quotidien.

En Suisse, les médicaments contenant les principes actifs méthylphénidate, dexméthylphénidate, lisdexamfétamine et atomoxétine sont autorisés pour le traitement du TDAH chez l’adulte. Les médicaments modifient les interactions entre certains neurotransmetteurs dans le cerveau et peuvent atténuer les symptômes du TDAH.
Des interventions psychosociales sont surtout appliquées dans les situations suivantes:

Différents concepts avec divers points focaux sont proposés. Ils ont toutefois des points communs sur le plan du contenu, comme la gestion de la désorganisation, l’amélioration de l’attention ou le contrôle des impulsions. Il s’agit avant tout d’apprendre à gérer les symptômes et de consolider cet apprentissage. Les thérapies de groupe ou individuelles peuvent être prometteuses à cet effet.

02/2021 337375-062101
Vous trouverez également l'auto-évaluation dans notre guide!
0/2023 092301 NPS-CH-00658